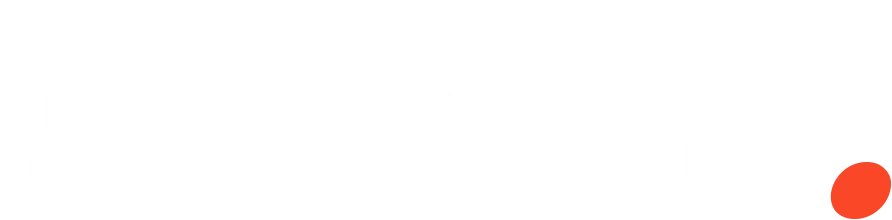Le jour de Yom Hashoah
Souvenirs de la lecture annuelle publique des noms des déportés juifs français
Le jour de Yom Hashoah, c’est le jour le plus difficile à comprendre. On est dans un des plus beaux quartiers de Paris, je suis habillée joliment, sobrement mais je suis précisément contente d’être jolie. Il fait beau mais pas trop. Il fait lumineux, et on entend le bruit de mes petits talons sur les pavés de la rue. C’est silencieux, comme un consensus avec les rues, un silence religieux, ou un silence du renégat résolu à se battre avec tout ce qui se prendrait pour Dieu, ou de l’athée qui n’est plus soucieux de se justifier, mais un silence. Et je tiens dans mes mains une liste. De juifs montés au ciel. Eux, ils tenaient des listes aussi. C’était aussi des listes de juifs. Mais qu’ils allaient faire mourir. Sans se soucier qu’ils montent au ciel. De toute façon c’est toujours du papier froissé. Et aucune des deux sortes de liste ne les a fait complètement vivre ou complètement mourir. Ils errent comme des fantômes entre les murs du mémorial et dans les greniers de leurs anciens appartements.
Je discute dans le mémorial. De la synagogue, des témoins que j’ai entendu, de ceux que j’aimerais entendre, de ceux que je n’entendrais jamais plus. Ma mère est là pour accueillir les lecteurs. Elle leur sourit avec ses yeux bruns, ses petites boucles cuivrées et son sourire paisible. Et il fait beau, au dessus de la cours où on scande les noms et les prénoms de nos juifs. Il fait beau, au dessus d’un ancien four crématoire, trônant au milieu de l’assistance qui écoute ses noms. Il fait beau, d’un beau parisien de moi d’avril-mai, quand je ne suis pas encore en vacances mais que j’ai déjà reçu mon bulletin du deuxième trimestre. Peut être qu’il va pleuvoir avant la fin de la journée, alors je penserai que le ciel pleure.
Je vais diner dans un bon restaurant à côté du mémorial, après avoir lu nos noms. Y a que ça à coté du mémorial, que des bons restaurants. Je mange un repas de fête tout bariolé et tout content d’être servi, chaud. Et la sensation d’être rassasiée me gêne, comme si j’avais cassé le jeûne de Kippour. Mais on n’est pas Kippour. On ne sera jamais Kippour, aujourd’hui. Parce que le silence n’est pas celui de Kippour. Ce jour là je sens que je ne serais jamais seule. Les adultes me disent que « c’est bien », quoi ? Je ne sais pas bien, mais « c’est bien, les enfants ». Alors je mange, je ris mais je n’ose pas rire trop fort, je ne voudrais pas que ça réveille les morts, ou pire, leur faire croire que ma lecture m’aura paru suffisante pour honorer leur mémoire. Alors je fais des projets heureux plutôt que d’avoir des fous rires maintenant. Mais j’en ai quand même eu des fous rires, à force d’être sérieuse à propos de choses pas sérieuses du tout. Tout ces massacres, ça n’est pas sérieux du tout, mais c’est relaté dans des livres tellement sérieux écrits par des gens très cultivés habillés dans des costumes très sérieux qui te regardent sérieusement quand tu leur poses une question et que tu essaies d’avoir l’air sérieux.
Mais là où je suis véritablement sérieuse, c’est sur cette estrade où je vais bientôt monter. Et quelque chose dans ma gorge monte aussi. Je dis ces noms, plutôt je scande ces noms, ils quittent mon estomac. Je les avais bien répétés avant, ils sont difficiles à dire. Et les fleurs poussent sur les buissons qui entourent le mémorial, tandis que se fane l’écho de chaque nom que je finis d’articuler. Puis un kaddish est prononcé. Avec une solennité différente de celle qui embaume le kaddish d’un père qui, paisiblement, meurt de vieillesse. Je le sens dans le silence des murs gris, dans le silence des lèvres qui crient des mots qu’on n’entend pas, et qui s’adresse à l’homme qui a donné des leçons à l’enfer. Je me demande s’ils pensent encore à cet homme, peut-être qu’ils n’y pensent plus du tout. Triste ou écœurée d’une chose qui me sera éternellement inconnue, j’écoute.
Certains sont en vacances d’autres loupent un jour d’école. Quand c’est comme ça, on a l’excitation de l’école buissonnière, on forcera le respect de nos camarades de classe et surtout celui des profs. Je sens qu’on fait un truc bien, qu’on répare quelque chose doucement, avec nos petites voix fluettes et nos oreilles grandes ouvertes. On sent qu’on est responsables parce que les adultes nous le disent, les vêtements propres et élégants qu’on a mis aujourd’hui le disent aussi, alors on se dit qu’on va prendre des responsabilités toute notre vie.
Johanna Zarur